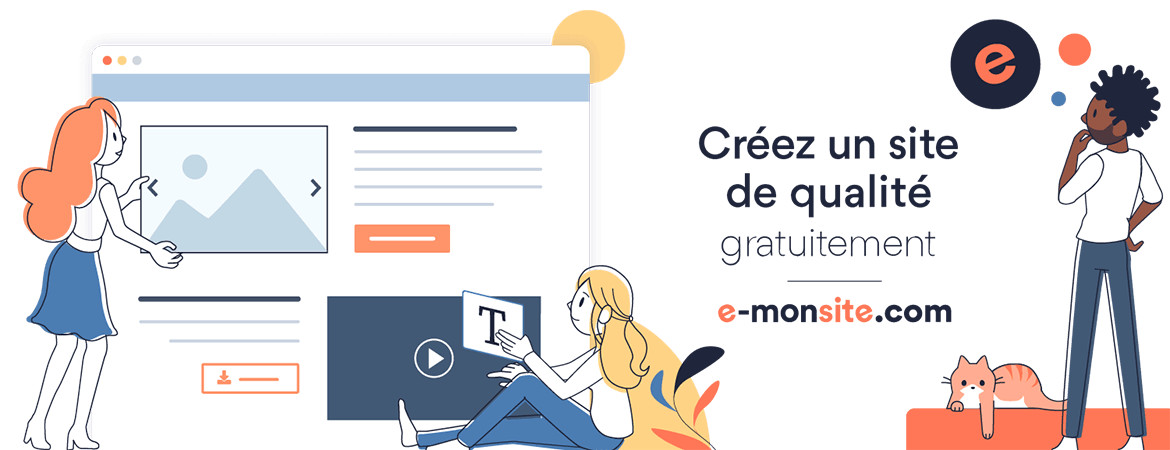- Accueil
- Discrimination / Genre
- Badinter
Trois textes de madame Badinter nous ne sommes pas entièrement d'accord avec chaque réponse mais il y a de nombreux éléments intéressants :
http://www.humanite.fr/2003-06-20_Tribune-libre_-Le-feminisme-d-Elisabeth-Badinter
Le féminisme d’Élisabeth Badinter
Dans son dernier ouvrage, l’écrivaine et essayiste précise ce que devraient être les nouvelles priorités du combat pour l’émancipation féminine, en évitant les pièges du victimisme à l’américaine.
Dans Fausse route, votre dernier ouvrage, vous mettez en garde le féminisme français et européen, trop influencé selon vous par le modèle américain. Quelle a été la genèse de votre livre ?
Élisabeth Badinter. Jusqu’en 1992, j’ai toujours été en phase avec les revendications féministes. Mais à partir du débat sur le harcèlement sexuel et la volonté de certaines associations d’étendre la notion de harcèlement au-delà du rapport hiérarchique dans le travail, c’est à dire au harcèlement horizontal, j’ai compris qu’on traçait une autre image de la femme. J’ai eu une oreille à la fois attentive et de plus en plus critique sur les thèmes abordés par le féminisme, sur la façon de les aborder, sur les objectifs prioritaires de ce féminisme. Et puis, l’année dernière, j’ai vraiment pris un coup de sang, au moment du débat sur la prostitution, face à la montée en puissance du discours abolitionniste. C’était l’avènement d’une bien-pensance féministe que je redoutais. Le coup de sang est venu du fait qu’on ose, quand on est féministe, refuser la parole à d’autres femmes, les prostituées. C’est là que j’ai émis cette idée de " victime absolue ", celle dont il est inutile d’écouter le propos. Cela m’a bouleversée.
Vous dénoncez le victimisme et le différentialisme, contraire à l’universalisme. Dérives qui pour vous risquent de détériorer encore les relations entre hommes et femmes. Or remettre en cause le victimisme ne revient-il pas à remettre en cause l’existence d’une domination masculine ?
Élisabeth Badinter. Le féminisme de Beauvoir dont je me réclame n’est pas victimiste. D’un point de vue philosophique, il a été le moteur de ma réflexion. Je voudrais montrer que ce parti pris de victimisme peut se retourner contre les femmes. Contrairement à ce que l’on pense, il introduit une image désastreuse de la femme. Dans les années quatre-vingt, on a mis en lumière une ignominie invisible concernant les femmes violées. Je rends hommage à Gisèle Halimi et à ce vrai travail féministe, efficace et fondamental, qui a aidé ces femmes à relever la tête, à mener le combat pour faire reconnaître que c’était elles les victimes. Mais bizarrement, à partir de là, un dévoiement a consisté à étendre la notion d’agression sexuelle à des comportements et des attitudes masculines qui sont d’un autre ordre. Ce qui induit deux images catastrophiques pour le rapport homme-femme : d’un côté une femme impuissante qui n’a pas la force de résister aux hommes, assimilée à une sorte d’enfant sans défense, qui en appelle aux tribunaux comme on en appelait à papa-maman avant. De l’autre côté, on trace dans la conscience ou l’inconscience publique l’image d’un homme agressif, dominateur, exploiteur. Il y a certes des hommes qui sont des salauds, il y a plus de violence masculine que féminine, et des femmes sont victimes de ces hommes, mais, encore une fois - et c’est tout le point de la discussion philosophique -, ces femmes victimes ne disent pas tout de la condition des femmes. Ces hommes exploiteurs, violents, ne sont pas caractéristiques du genre masculin.
80 % des condamnés pour homicide involontaire et pour coups et violence sont des hommes. Comment lire ce chiffre ?
Élisabeth Badinter. Les statistiques sont indiscutables. Mais avez-vous remarqué que personne ne travaille sur la violence féminine ? Or, à la lumière des faits divers, on observe une montée de la violence des jeunes adolescentes. Mon explication, c’est que la violence n’est pas inhérente aux hommes. Les garçons des banlieues et des cités sont prisonniers des schémas de virilité, de masculinité archaïque. La montée du féminisme a fait éclater le concept d’identité masculine. Mais eux n’ont pas les moyens de se construire une identité plus souple, moins schématique. Les jeunes filles de 14-15 ans, pour se défendre, commencent à avoir des comportements similaires à ceux des garçons. Cette violence-là va de plus en plus s’exprimer. Elle ne peut donc pas définir spécifiquement le genre masculin. Elle appartient à la nature humaine, et certaines conditions sociales ou psychologiques en sont le détonateur.
Le mouvement " Ni putes, ni soumises " entend ne pas opposer la question sociale et la lutte pour l’égalité des sexes ?
Élisabeth Badinter. En lisant les déclarations des unes et des autres, j’étais surprise de découvrir qu’elles refusaient de se dire féministes. Quand je les ai rencontrées, je leur ai demandé : " Comment pouvez-vous dire que vous n’êtes pas féministes, vous vous battez bien pour l’égalité des sexes ? " Elles m’ont répondu qu’elles ne se retrouvaient pas du tout dans le discours féministe actuel. Pourquoi ? " En aucun cas, nous ne voulons rompre avec les garçons des cités. On progressera avec eux ", m’ont-elles répondu. Je les trouve formidables. Il n’est pas question de se séparer des garçons, c’est pour cela qu’elles se retrouvent sur la critique sociale. Quand j’écoute Fadela Amara, elle dit ce que je ressens : " Les garçons souffrent beaucoup, il faut qu’on les emmène avec nous. " Pour moi, c’est le féminisme dans toute sa grandeur.
Vous êtes très critique sur la loi sur la parité ?
Élisabeth Badinter. La parité est à la fois une mesure technique de rattrapage et un grand débat philosophique. 5 % de femmes, c’est de la discrimination négative implicite. S’est ensuivi un débat compliqué pour justifier l’introduction de la différence des sexes dans la Constitution. Devant cette pathologie politique, que dire des quotas ? J’aurais accepté qu’on se mette d’accord sur une politique volontariste. Exemple : devant une situation qui n’est pas acceptable, pendant cinq ans chaque parti s’engage à faire rentrer, comme des quotas déguisés, 30 % ou 50 % de femmes. Et puis on arrête. Pas de loi. La question de la loi est insupportable à mes yeux pour deux raisons. La première, c’est la sexualisation de la citoyenneté, et avec elle le retour du déterminisme biologique. Ce que je trouve redoutable pour les femmes et contraire aux acquis universalistes. Deuxième point, les femmes qui ont défendu la parité ont montré un égoïsme contraire à leur supposé nature altruiste : " Les quotas pour nous, pas pour les autres. " Or quand je regarde l’Assemblée nationale, je ne vois pas de Français de la première génération, je ne vois pas de Français de moins de vingt-cinq ans, je ne vois pas d’ouvriers, je ne vois pas représentés de nombreuses catégories de la population. Du coup, au lendemain de la loi votée sur la parité, on a vu des associations de Français d’origine africaine et maghrébine dire " pourquoi pas nous ? " Ce que je comprends très bien. De plus, le discours convenu sur les femmes en politique consistant à dire qu’il y a un point de vue féminin, une appréhension féminine de la société, qu’une femme est plus douce, plus pacifique, plus altruiste, plus dévouée à la collectivité…, cela fait franchement sourire quant on connaît le monde politique.
Comment poursuivre aujourd’hui ce combat féministe pour l’égalité, et comment penser la relation entre les hommes et les femmes ?
Élisabeth Badinter. Pour moi, le thermomètre objectif de l’inégalité entre les hommes et les femmes reste l’écart des salaires. Depuis dix ans, rien n’a bougé. C’est le critère de l’échec du féminisme. Pourquoi ? Parce que l’égalité des sexes se joue aujourd’hui dans l’intime, dans la famille, dans le privé. Tant que les femmes assument 80 % des charges ménagères et parentales, elles courent avec un gros boulet au pied par rapport aux hommes. Ce n’est pas un hasard si le temps partiel est assuré à 80 % par des femmes. Or, tant que le féminisme tient un double discours - pour moi schizophrène - consistant à dire qu’il y a une différence essentielle entre l’homme et la femme (la puissance maternelle) et en même temps de trouver insupportable la double journée de travail féminin, on fera du surplace. Soit hommes et femmes peuvent tout partager, y compris la parentalité et le ménage, soit il n’y aura jamais d’égalité des sexes.
Les dernières mesures du ministre de la Famille ouvrant le congé parental dès le premier enfant sont donc dangereuses pour les femmes ?
Élisabeth Badinter. Ce congé parental de six mois devrait être accordé trois mois à la mère, trois mois au père. Ce qui serait un moteur pour le partage des tâches. Comme dans le modèle suédois. En revanche, le congé de paternité, voté en janvier 2001, est une avancée symbolique formidable. Un tiers des nouveaux pères l’ont pris l’année dernière.
J’attends que les féministes disent aux jeunes femmes que leur priorité absolue reste l’indépendance économique. Qu’ils leur rappellent : " Si vous vous arrêtez de travailler vous prenez un risque considérable au vu de la situation économique actuelle. N’oubliez jamais que votre espérance de vie dépasse 80 ans, et que le temps de maternité active est au plus de 15 ou 20 ans. " On ne joue pas sa vie sur 15 ou 20 ans. Il faut donc également lutter pour une politique volontariste en faveur des crèches.
Parlez-nous de votre crainte du séparatisme entre les sexes, d’un " nouveau dualisme sexuel oppositionnel ", comme vous l’appelez.
Élisabeth Badinter. La différence entre les sexes existe, bien sûr. Elle est de l’ordre du biologique, de la sexualité, c’est indiscutable. Mais est-ce que cette différence commande l’ensemble des relations entre les hommes et les femmes ? Je ne le crois pas. La loi sur le harcèlement sexuel est en train de nous expliquer qu’il y a une sexualité licite et illicite. Selon le modèle du féminisme américain. On cherche à modeler la sexualité masculine sur le modèle féminin. La question du sentiment et du sexe serait spécifiquement féminine. Or, certaines femmes ont des comportements sexuels que l’on peut qualifier de traditionnellement masculins. Nous sommes différentes entre nous. Et cette diversité me plaît. De plus, à partir des années soixante-dix, la bisexualité psychique a été reconnue. Les hommes et les femmes ont été autorisés à ne plus refouler l’autre partie de soi. Mon hypothèse, c’est que cette libération est une des raisons de l’allongement de la vie des gens ! Mais notre finalité est une meilleure entente entre hommes et femmes. Pour continuer à avancer, il faut admettre que nous avons beaucoup en commun et que l’on peut tout partager.
Entretien réalisé par Maud Dugrand
http://www.humanite.fr/popup_imprimer.html?id_article=372917
Élisabeth Badinter Un féminisme bien tempéré
La philosophe Élisabeth Badinter estime que le courant de pensée féministe est aujourd’hui menacé de régressions qui remettent en question ses acquis historiques.
Élisabeth Badinter, Fausse route, Éditions Odile Jacob, mars 2003, 224 pages, 17 euros.
Où en est le mouvement féministe ? Il serait étonnant que le désenchantement provoqué par la contre-offensive libérale, ait épargné cette force émancipatrice. L’ouvrage d’Élisabeth Badinter, qui ne se réclame de personne d’autre que d’elle-même, donne la mesure des périls et des régressions qui menacent aujourd’hui le courant de pensée féministe et ses acquis. Elle invite d’emblée à un effort de mémoire. L’augmentation massive des femmes sur les lieux de travail a indirectement accru le champ de leur pouvoir. La victoire qu’ont représenté l’acquisition du droit à la contraception et à la liberté de disposer de son propre corps, la possibilité d’être mère quand elles le veulent, le recul théorique des discriminations fondées sur la hiérarchie des genres, la condamnation sociale des harcèlements sexuels ou moraux, la tentative d’imposer la parité dans la hiérarchie politique et dans la vie publique, nécessite aujourd’hui un effort de mémoire pour qui veut se souvenir de la situation des femmes avant les années 1970. Pour autant, les effets millénaires d’une tyrannie qui continue de cantonner les femmes dans les " seconds rôles ", subsistent. Certaines figures contemporaines du féminisme vont jusqu’à prétendre que rien n’a changé et que la situation de la femme est aujourd’hui pire qu’elle ne l’était hier. Sauf à considérer qu’en matière de déterminations, la nature l’emporte sur la culture, cette position apparaît difficile à tenir. La " victimisation " non pas du sexe féminin mais du " genre " qui est une construction abstraite, si elle permet d’unifier artificiellement les divergences, se heurte - selon Élisabeth Badinter - à deux obstacles. D’abord, la généralisation de la souffrance " victimaire " des femmes tend à conférer au genre masculin une essence quasi sadique et à généraliser comme effet d’une même violence naturelle ou domestique la situation des femmes, quelle que soit la culture dont elles héritent. En matière de haine, insidieuse ou non, il y a des degrés à distinguer. Comme l’écrit l’auteur, la bourgeoise du 7e arrondissement et la jeune beurette des banlieues ne mènent pas leur combat dans les mêmes conditions. Le discours féministe médiatisé qui est questionné, reflète-t-il les aspirations de la majorité de la population féminine ? Telle est la première interrogation d’Élisabeth Badinter. D’autre part, se demande-t-elle sur quelle logique repose ce discours et quel modèle féminin veut-il imposer ? La violence spécifique exercée envers les femmes n’a pas disparu. Le viol et le harcèlement sexuel, bien qu’ils soient relativement déconsidérés aux yeux de l’opinion publique, sont en augmentation. 37 % des Françaises se plaignent désormais de " pressions psychologiques " ; ce nouveau concept élargit le champ des crimes sexuels. L’auteur se demande au service de quelle idéologie - la féministe ou la sécuritaire - sont établies ces statistiques. Élisabeth Badinter reconnaît que " Françoise Héritier a raison d’insister sur notre universelle tendance à penser la différence sous le signe de la hiérarchie et de l’inégalité, mais elle a peut-être tort de la lier à l’appropriation masculine de la fécondité féminine " (page 56). Si la différence continue d’être massivement pensée en termes d’inégalité, peut-être est-ce parce qu’il est plus facile de penser à travers cette catégorie politico-philosophique (d’égalité/inégalité) que d’analyser en termes de désir de filiation directe, l’essence historique de la suprématie masculine ? Quant à la suppression de la domination, elle reste, bien évidemment pour l’auteur, un objectif inhérent à toute entreprise de libération humaine. L’auteur de l’Amour en plus : histoire de l’amour maternel invoque ici, à juste titre, un " malaise philosophique " et une difficulté à valider la notion de " domination masculine ". Le militantisme féministe se heurte, comme n’importe quelle activité émancipatrice, à la difficulté de prendre en compte la diversité de ceux et celles auxquels il s’adresse. La dissymétrie entre le nombre de condamnés masculins pour homicide (86 %) et celui des condamnées féminines, révèle un certain lien entre la survivance de pratiques barbares et la masculinité. Certes, les femmes peuvent être atteintes de déviances sadiques ou accomplir des crimes d’intérêt, mais l’idée selon laquelle le genre féminin serait moins prédisposé à la violence que le genre masculin reste forte. La sexualité masculine n’est pas la racine universelle du mal. Beaucoup de travaux sociologiques contemporains continuent de mettre à jour les différences sociales mais aussi psychologiques entre le désir féminin et le désir masculin. Pour Élisabeth Badinter cette différence ne doit se penser ni en termes d’inégalité, ni en termes de différence de nature. Il s’agit d’un acquis de civilisation. Ni le sexe, ni le genre, ni la sexualité ne prédétermine un destin. Depuis dix ou quinze ans, le discours féministe médiatisé et dominant tend à distinguer hommes et femmes comme deux entités aux intérêts différents. Cela est incompatible, estime l’auteur, avec la militance des uns et des autres pour l’indifférenciation des rôles, qui est " pourtant la seule voie vers l’égalité des sexes ". Reconnaître le caractère émancipateur du travail féminin, sans oublier de socialiser le système de crèches, conclut-elle, fera plus que tous les discours sur la parité, car " l’égalité se nourrit du même et non du différent. À méconnaître cette logique élémentaire, à vouloir forcer le sens des termes, on aboutit au contraire de ce que l’on désire ".
Arnaud Spire
LA VERITE SUR LES VIOLENCES CONJUGALES - ARTICLE D'ELISABETH BADINTER
[ Mercredi 01 Mars, numéro 88 ]
L'Express du 20/06/2005
La vérité sur les violences conjugales
par Elisabeth Badinter
"Dans les enquêtes et discours sur les violences conjugales, le partage des rôles sonne comme une évidence: les hommes sont coupables et les femmes sont victimes. Un présupposé justifié par les faits, étayé par les statistiques, quand il s'agit des violences physiques, coups, viols, meurtres. Mais, dans la plupart des cas, incantations et travaux mélangent tous les types de violence conjugale, celle des poings et celle des mots. C'est l'addition à laquelle s'est livrée la seule étude sérieuse menée en France sur ce sujet, l' «Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France» (Enveff), rendue publique en 2001. De ses conclusions est sorti un «indice global» de la violence conjugale: 10% des femmes s'en déclarent victimes. Ce chiffre effrayant et la terminologie utilisée occultent le fait que les trois quarts de ces «violences» sont des agressions psychologiques - insultes, dénigrement ou harcèlement. Une question se posait: et les hommes, massivement accusés à l'aune de ces agressions psychologiques, ne leur arrive-t-il pas d'en être victimes, eux aussi? Selon l'étude réalisée par l'institut BVA pour L'Express, hommes et femmes se déclarent à peu près également victimes de cette guerre conjugale, qu'on doit hésiter à qualifier de «violence», fléau trop grave pour être abandonné aux mots. Il faut s'en tenir aux faits: c'est le sens du combat mené sur ce sujet par la philosophe Elisabeth Badinter, dont nous publions le discours prononcé lors d'une conférence-débat organisée, le 16 juin, à Lyon, par Amnesty International
Cette enquête est une grande première. Poser aux femmes et aux hommes les mêmes questions sur les tensions qui peuvent exister au sein de leur couple constitue une rupture avec le discours dominant sur les «violences conjugales». Constater qu'hommes et femmes se plaignent à peu près également l'un de l'autre (et, même, que les hommes subissent deux fois plus d'insultes que les femmes) renforce le double malaise que j'ai toujours éprouvé, d'une part à l'égard de la méthode habituellement choisie pour parler des violences faites aux femmes et, de l'autre, à l'égard des conclusions que l'on en tire.
D'abord, la méthode revendiquée par la plupart des institutions ou associations est globalisante: la violence des hommes contre les femmes est, nous dit-on, universelle. On lit, par exemple, dans la brochure d'Amnesty International (2004): «Partout dans le monde, des femmes subissent des actes ou des menaces de violence. C'est une épreuve partagée, au-delà des frontières, de la fortune, de la race ou de la culture. A la maison et dans le milieu où elles vivent, en temps de guerre comme en temps de paix, des femmes sont battues, violées, mutilées en toute impunité.»
Cette approche fait un amalgame entre toutes les sortes de violences, pourtant de nature différente: violences en temps de guerre et en temps de paix. Violences d'Etat et violences privées. La violence du mari ou du compagnon, celle du harceleur sexuel ou moral, du soldat ou du trafiquant. Amalgame aussi entre la Parisienne harcelée dans les transports et la petite Nigérienne victime d'un trafic sexuel ou la Jordanienne victime d'un crime d'honneur. Violence psychologique et violence physique. Violence des Etats totalitaires et patriarcaux, et violence des Etats démocratiques.
Cette approche admet aussi un continuum des violences en mettant sur le même plan la menace d'une gifle conjugale et la lapidation d'une femme adultère: «La main aux fesses dans le métro, les sifflets dans la rue, les coups, les insultes, les humiliations du conjoint, les mariages forcés, les filles violées, etc.» (Collectif national pour les droits des femmes, 2005). Faute de distinctions, on additionne des actes hétérogènes qui ressemblent à un inventaire à la Prévert, où tout vaut tout: l'agression verbale, les pressions psychologiques et les atteintes physiques.
Enfin, il me semble qu'on est peu regardant sur les statistiques utilisées et encore moins sur leurs sources ou leur interprétation. Ainsi, dans l'opuscule d'Amnesty, on lit: «Au moins 1 femme sur 3 a été battue, forcée à des rapports sexuels ou violentée d'une manière ou d'une autre à un moment de sa vie» (Population Reports, n° 11, Johns Hopkins, School of Public Health, déc. 1999). Que signifie «violentée d'une manière ou d'une autre»? Faute de précision, on ne retiendra qu'une chose, à savoir que 1 femme sur 3 est battue ou violée.
Pis: sur Internet, on trouve que «près de 50% des femmes dans le monde ont été battues ou maltraitées physiquement à un moment de leur vie par leur partenaire». Selon le Conseil de l'Europe, la violence domestique est, pour les femmes de 16 à 44 ans, la principale cause de mort et d'invalidité, avant le cancer ou les accidents de la route. Propos lancés par les féministes espagnoles en 2003, cités partout, notamment dans le rapport du Conseil de l'Europe. Ai-je été la seule à sursauter en lisant cela? Les statistiques de l'Inserm indiquent que, pour 2001, 2 402 femmes âgées de 16 à 44 ans sont mortes des suites d'un cancer!
L'Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Population & sociétés, janvier 2001) révèle un indice global de violence conjugale à l'encontre des Françaises de 10%, qui se décompose bizarrement ainsi: insultes et menaces verbales (4,3%), chantage affectif (1,8%), pressions psychologiques (37%), agressions physiques (2,5%), dont répétées (1,4%), viols et autres pratiques sexuelles imposées (0,9%). Les journalistes et les politiques traduisent: 10% de femmes sont battues en France. Tous les 8 mars, nous avons droit à cette affirmation erronée, sans que jamais personne ne songe ni à consulter les chiffres ni, évidemment, à les rectifier.
Quatrième illustration de l'utilisation publicitaire des statistiques: en 1980, deux chercheuses, Mmes Linda MacLeod et Andrée Cadieux, publient un rapport sur la femme battue au Québec et annoncent les chiffres de 300 000 femmes battues et de 52 femmes assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint. Durant vingt-quatre ans, les «300 000» deviennent le leitmotiv des mouvements féministes québécois, jusqu'à ce que l'Institut de la statistique du Québec publie une enquête digne de ce nom, en 2004, qui ne compte plus que 14 209 femmes se disant victimes de violences conjugales. Quant aux 52 Québécoises assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, les chiffres publiés par la Sécurité publique du Québec en 2000-2001 donnent 14 femmes et 7 hommes assassinés par leur conjoint. Linda MacLeod a reconnu son erreur dès 1994. Elle s'est défendue en disant: «Je me sentais sûre de ce chiffre, parce qu'il reflétait une réalité corroborée par ceux et celles qui travaillaient sur la ligne de front. C'était une supposition admise.» Je ne mets pas en doute la bonne foi de ces chercheuses, mais je ne peux m'empêcher de penser que c'est moins la vérité que l'on cherche que la confirmation de présupposés. On charge la barque des violences masculines, on gonfle les chiffres au maximum au point de les défigurer, comme si s'exprimait là le désir inconscient de justifier une condamnation globale de l'autre genre. L'enjeu n'est plus la condamnation des hommes violents, la seule légitime à mes yeux, mais celle des hommes en général.
D'où ma stupéfaction devant l'utilisation par les Nations unies, reprise par Amnesty, de l'expression «violence de genre». Expression tirée des travaux des féministes anglo-saxonnes les plus radicales, publiés dans les années 1980-1990. Que signifie «violence de genre»? Faut-il comprendre que la violence est le propre du mâle? Que la masculinité se définit par la domination et l'oppression de l'autre sexe? Que les femmes ignorent la violence?
L'enjeu des termes est considérable. Car, si l'on admet cette notion de «violence de genre», on en revient à une définition duelle et opposée de l'humanité: les bourreaux contre les victimes, ou le mal contre le bien. Je pense, pour ma part, que l'on commet une double erreur. D'une part, le concept de «violence de genre» ne me paraît pas fondé. D'autre part, en globalisant la violence masculine, sans la moindre distinction qualitative, culturelle et politique, on se condamne à n'y rien changer.
Les dérapages de la vie à deux ne suffisent pas à définir le «terrorisme conjugal»
Pour tenter de convaincre que la violence n'est pas le propre d'un genre, je m'en tiendrai aux violences conjugales dans les démocraties occidentales, où l'on est censé avoir une approche plus fouillée et plus scientifique de la question.
Premier constat: les enquêtes à notre disposition, tant en France qu'en Europe, notamment celles du Conseil de l'Europe, me semblent trop souvent partielles et donc partiales. Elles sont partielles parce qu'elles ne concernent que les victimes femmes. On a choisi partout, délibérément, d'ignorer s'il y avait des hommes victimes. La justification avancée de cette omission est toujours la même. Elle tient en deux arguments: nous n'avons pas de statistiques, mais nous avons de bonnes raisons de croire que 98% des violences conjugales sont le fait des hommes (cf. Marie-France Hirigoyen dans L'Express du 25 avril 2005: «Les hommes? On ne les a pas sondés. On leur confère par définition le statut d'agresseurs: ils le sont dans 98% des cas»). Quant à la violence des femmes, elle ne serait qu'une légitime défense contre la violence première des hommes.
Second constat: faute de travaux indiscutables, les chiffres les plus fantaisistes circulent. Exemple: y a-t-il en France 6 femmes tuées tous les mois par leur conjoint ou ex-conjoint, soit 72 par an, ou 400, comme on l'a dit à l'émission de TF 1 Le Droit de savoir? Et comment évaluer l'ampleur et la signification de ce phénomène quand les statistiques judiciaires et policières ne distinguent pas entre les femmes mortes de violences conjugales et les autres?
En attendant, je voudrais montrer que la violence n'a pas de sexe, en mettant en lumière quelques aspects de la violence féminine dont on ne parle que rarement. En ce qui concerne la violence conjugale féminine, comme d'habitude, il nous faut recourir aux travaux du continent américain pour y voir plus clair. En particulier, à la dernière enquête faite pour l'Institut de la statistique du Québec par Denis Laroche, dont les statistiques ont été entérinées par le très féministe Conseil du statut de la femme du Québec en février 2005. A ma connaissance, c'est la première enquête francophone de grande envergure concernant les violences conjugales, qui traite à la fois de la violence masculine et féminine. C'est aussi la première enquête qui distingue violence grave et violence mineure, en dressant une liste de 10 situations de violences physiques qui vont de la menace aux actes. D'où il ressort quatre informations essentielles: dans les cinq dernières années qui précèdent l'enquête, 92,4% des hommes et 94,5% des femmes se sont déclarés exempts de violence physique. En 2002, au Québec, 62 700 femmes et 39 500 hommes se sont dits victimes de violence conjugale (toutes violences confondues). Les actes d'agression subis par les hommes et les femmes ne sont pas exactement les mêmes. Les femmes sont plus victimes de violences physiques graves que les hommes. Parmi elles, 25% ont été battues (pour 10% d'hommes), 20% ont failli être étranglées (4% des hommes), 19% ont été menacées avec une arme (8% des hommes). Sept fois plus de femmes que d'hommes ont été victimes d'agression sexuelle. En revanche, selon les études canadiennes, hommes et femmes sont quasi à égalité face aux «violences» psychologiques.
Les Canadiens ont repris du psychologue américain Michael P. Johnson (2000) la distinction, qui me paraît fondamentale, entre deux types de violences conjugales: le «terrorisme conjugal» et la «violence situationnelle».
La violence grave qui s'effectue dans un «contexte de terrorisme conjugal» se définit par la volonté d'annihiler le conjoint, de toutes les manières, psychologiquement et physiquement. Cette violence-là provient majoritairement des hommes.
Alors que la majorité des hommes victimes de leur conjointe le sont dans un contexte de «violence situationnelle», qui renvoie soit à l'autodéfense de la femme, soit à la violence réciproque, soit à la lutte pour le pouvoir des deux conjoints. Au passage est introduite la notion de «violence interactive», essentielle pour comprendre une bonne partie des violences conjugales.
On remarquera donc que, si les femmes sont majoritairement victimes de violences, et en particulier physiques, il leur arrive à elles aussi d'exercer cette violence-là, quand elles sont en position de domination physique ou psychique.
Pour s'en convaincre, il faut se pencher sur la violence des femmes à l'égard des plus faibles. D'abord à l'égard des enfants, sujet peu évoqué, quelques études donnent à réfléchir. Le dernier rapport de l'Odas (Observatoire national de l'action sociale décentralisée, dont dépend l'Aide sociale à l'enfance), de décembre 2004, indique le chiffre de 89 000 enfants en danger en France, dont 18 000 enfants maltraités.
Le rapport d'activité 2002 de l'Accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée indique que 76,2% des auteurs de mauvais traitements sont les parents, dont 48,8% sont les mères et 27,4% sont les pères des tout-petits, chiffres qui sont probablement sous-estimés. Enfin, le rapport de l'Unicef 2003, sur les décès d'enfants des suites de maltraitance dans les nations riches, fait état de 3 500 décès d'enfants de moins de 15 ans par an. Le rapport ne précise pas la proportion de pères et de mères infanticides, mais il serait mal venu d'en accuser un seul des deux sexes.
Une enquête épidémiologique est en cours en France, effectuée par l'Inserm. Les premiers résultats révèlent une sous-estimation des morts par maltraitance d'enfants de moins de 1 an, qu'on aurait attribuées à la «mort subite du nourrisson» (cf. Journal de l'Inserm, mai-juin-juillet 2003). Or qui, majoritairement, prend soin des nourrissons dans notre société? Enfin, je me contenterai de mentionner l'existence de la pédophilie féminine, qu'on a semblé découvrir depuis à peine un an avec les procès d'Outreau et d'Angers. Je rappelle que dans ce dernier, on comptait, dans le box des accusés, 29 femmes et 37 hommes. Mais sur cette violence-là, nous n'avons, à ce jour, aucune étude sérieuse.
Au demeurant, les enfants ne sont pas les seuls êtres faibles susceptibles de pâtir de la violence féminine. La maltraitance des vieilles personnes est un autre sujet qui implique cette violence féminine. En 2003, le ministre des Personnes âgées faisait état du chiffre de 600 000 qui seraient maltraitées. Maltraitance souvent d'origine familiale, à domicile. Mais, que ce soit dans les familles ou dans les institutions, ce sont les femmes qui s'occupent majoritairement des vieux, comme elles s'occupent majoritairement des plus jeunes.
Reste un sujet toujours tabou qui n'a fait l'objet que de très rares et parcellaires travaux - spécialement en France: la violence au sein des couples de lesbiennes. Une étude de l'Agence de santé publique du Canada de 1998 conclut qu'il y a la même proportion de violence dans les couples gays et lesbiens que dans les couples hétérosexuels. Toutes violences confondues, 1 couple sur 4 fait état de violence en son sein.
De tous ces chiffres fastidieux mais nécessaires, il ressort qu'on ne devrait pas parler de «violence de genre», mais de «droit du plus fort». Un seul crime est indiscutablement plus propre aux hommes qu'aux femmes, c'est le viol, aujourd'hui puni en France aussi sévèrement que le meurtre. Reste qu'hommes et femmes, lorsqu'ils sont en position de domination, peuvent déraper dans la violence. Les photos d'Abou Ghraib en Irak l'ont démontré, comme l'avait déjà démontré la participation des femmes dans les génocides nazi et rwandais. Que les hommes aient été dans l'Histoire les grands responsables de la violence physique est une évidence. Ils sont, depuis des millénaires, les détenteurs de tous les pouvoirs - économiques, religieux, militaires, politiques et familiaux, c'est-à-dire les maîtres des femmes. Mais, dès lors que l'on assiste au partage des pouvoirs qu'appelle la démocratie, il est inévitable que de plus en plus de femmes, en position de domination, tendent à en abuser, c'est-à-dire à être violentes à leur tour.
Par ailleurs, il faut reconsidérer le concept de violence, utilisé aujourd'hui pour désigner n'importe quel acte, hors de tout contexte. Le même mot ne peut pas s'appliquer à un geste déplacé dans un lieu public et à un viol. Ni s'appliquer non plus à de nombreuses situations qui figurent dans les enquêtes de violences conjugales. Une remarque désagréable, une insulte, un acte autoritaire déplacé ou même la menace d'une gifle ne peuvent être, en tant que tels, assimilés à une atteinte destructrice de l'autre. Les dérapages de la vie à deux ne suffisent pas à définir le «terrorisme conjugal», qui est d'une tout autre nature et que de nombreux spécialistes définissent aujourd'hui comme «une dynamique de couple où l'un des partenaires porte atteinte à l'intégrité et à la dignité de l'autre par un comportement agressif, actif et répété dont le but est de le contrôler». Il me semble aussi déraisonnable de mettre sur le même plan la violence contre les femmes observée dans les Etats démocratiques et celle observée dans les Etats patriarcaux, non démocratiques. Dans ces derniers, la violence contre les femmes est une violence fondée sur des principes philosophiques, traditionnels et religieux qui sont à l'opposé des nôtres. Ce sont ces principes qui doivent être combattus. Seules l'éducation des femmes et leur mobilisation finiront par mettre fin à cette aliénation systématique, qui donne tous les droits à un sexe et tous les devoirs à l'autre.
En revanche, la violence à l'égard des femmes dans nos sociétés est tout à fait contraire à nos principes. Elle appelle la répression de ses auteurs, mais, contrairement à ceux qui disent que toute société est structurellement violente à l'égard des femmes, je pense qu'elle révèle avant tout une pathologie psychologique et sociale, qui nécessite des soins et une réflexion sérieuse sur nos priorités. L'augmentation de la violence que l'on observe dans les sociétés occidentales, quel que soit l'âge, le sexe, et le contexte social, est peut-être à mettre en relation avec une incapacité de plus en plus grande à supporter la contrainte des devoirs et une propension inquiétante à confondre droits universels et désirs individuels.
L'hiver 2005 nous a appris qu'il y avait une forte augmentation de la violence des jeunes, dans les écoles, les collèges et les lycées - jusqu'aux maternelles - et qu'elle touchait toutes les classes sociales. Enervements, incivilités, insultes et coups sont devenus l'expression d'une agressivité banale, y compris à l'égard de ceux qui sont censés nous aider et nous protéger, comme les professeurs ou les médecins. Entre 1999 et 2003, l'Insee indique que le nombre de Français victimes d'agressions (injures, menaces, coups) a crû de 20%. Dans ces conditions, on devrait s'interroger sur notre incapacité de plus en plus grande à supporter les frustrations et à maîtriser notre agressivité.
C'est notre éducation qui est en cause, et non nos principes. C'est elle qu'il faut changer. Depuis une trentaine d'années, l'épanouissement individuel et la satisfaction de nos désirs ont pris le pas sur le respect de l'autre et de la loi commune. Cela concerne tant les hommes que les femmes et n'a rien à voir avec ce qui se passe dans d'autres régions du monde où, à l'opposé, la loi est un carcan et où l'épanouissement individuel n'a tout simplement pas de sens. En vérité, nos sociétés ont autant besoin de réapprendre la notion de devoir que les autres, de réclamer leurs droits. En voulant à tout prix confondre les deux contextes, on se condamne non seulement à l'impuissance, mais aussi à l'injustice. A force de crier à la «violence de genre», on se rend coupable d'un nouveau sexisme qui n'est pas plus acceptable que le premier.
Elisabeth Badinter
Une guerre à deux
C'est dit tout net, de tableau en tableau. La guerre conjugale se pratique à deux. Sondés par l'institut BVA sur les tensions qu'ils ont pu vivre durant les douze derniers mois de leur vie de couple, les Français de 20 à 59 ans ont tous le sentiment d'avoir traversé au moins l'une des situations testées dans cette étude. 44% des personnes interrogées ont essuyé, de la part de leur conjoint, des remarques désagréables sur leur propre famille ou sur leurs amis(es). 34% se sont sentis dévalorisés et critiqués. 30% ont été la cible d'une jalousie questionneuse: «Où étais-tu, avec qui?» 29% ont vu l'autre décider de dépenses importantes sans tenir compte de leur avis. Et 25% ont dû supporter de le voir «cesser de parler, refuser totalement de discuter», bref, faire la gueule. Il y a pire, mais c'est un peu plus rare. 23% se sont entendu balancer des remarques désagréables sur leur physique - «T'es moche!» - et 22% sur leurs performances sexuelles. 23% accusent leur conjoint d'avoir méprisé leurs opinions en privé, et parfois en public (13%).
Mais le plus intéressant n'est pas là. La surprise, ce sont les hommes. Comme les femmes, ils se plaignent d'être à l'occasion rabroués, maltraités, déconsidérés. Plus souvent que les femmes, ils dénoncent le harcèlement jaloux de leur conjointe: 18% d'entre eux (pour 12% des femmes) déclarent que l'autre les empêche de parler à d'autres femmes (hommes). 34% des hommes (26% des femmes) déclarent que l'autre exige de savoir avec qui et où ils étaient; 33% (27% des femmes) que l'autre décide de dépenses importantes sans tenir compte de leur avis. Ce seraient les femmes qui hésiteraient le moins à décocher des critiques sur l'apparence physique. Et elles ne seraient pas les dernières à lancer des insultes ou des injures: 15% des hommes l'affirment, alors que 8% des femmes en accusent leur conjoint. Certes, il s'agit de déclarations. A manier avec précaution, donc. Mais il n'est pas forcément facile, pour un homme, de se dire l'objet de pressions psychologiques
Sur quelques questions, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à se déclarer victimes: leur conjoint les «dévaloriserait» plus souvent (37%, contre 30%) et s'attaquerait en particulier plus facilement à leurs compétences sexuelles (25%, contre 19%). A noter: sur certaines questions, les femmes répondent de façon plus pessimiste que dans l' «Enquête nationale sur la violence envers les femmes en France» de 2001. Le cadre de notre sondage, moins sombre et plus léger, a sans doute contribué à dédramatiser le sujet, et libéré la parole. S'il montre bien que les hommes et les femmes sont aussi capables les un(e) s que les autres de «violences» conjugales, il ne dit rien, évidemment, de toutes les querelles qui dérapent, le plus souvent au détriment des femmes, dans le fait divers."
Cet article est disponible sur Internet à l’adresse :
http://www.lexpress.fr/info/societe/dossier/violenceconju/dossier.asp?ida=433633